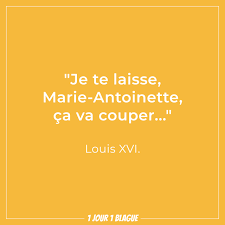La mort du roi, Louis XVI devant ses juges et face à l'Histoire. De Olivier Bétourné
3 participants
LE FORUM DE MARIE-ANTOINETTE :: Bibliographie :: Bibliographie : La Révolution française et le XIXe siècle :: Biographies, essais et études
Page 1 sur 1
 La mort du roi, Louis XVI devant ses juges et face à l'Histoire. De Olivier Bétourné
La mort du roi, Louis XVI devant ses juges et face à l'Histoire. De Olivier Bétourné
La mort du Roi
Louis XVI devant ses juges et face à l'Histoire
De Olivier Bétourné
Éditions Seuil (Sept. 2024)
320 pages

Présentation :
Plus de deux siècles après l’exécution de Louis XVI, nombreux sont les Français qui demeurent dans le doute. Qu’auraient-ils fait s’ils avaient dû personnellement se prononcer sur le cas de Louis XVI ? Jugeable ? Pas jugeable ? Et la mort, l’auraient-ils votée ?
Olivier Bétourné place le lecteur d’aujourd’hui en situation de se déterminer. Mais en l’invitant à entendre les arguments les plus contradictoires, il le conduit aussi à se confronter à un terrible dilemme : comment assumer la répulsion que nous inspire la mise à mort du roi déchu sans renoncer à comprendre la logique qui le conduit à l’échafaud ? Au plus près des acteurs du drame, le récit révèle la profondeur du conflit de légitimité qui hante la Convention et mine le souverain détrôné. Droit divin ou souveraineté du peuple ? Monarchie ou République ? À chaque instant de sa vie de reclus, le roi puise dans un environnement hostile des motifs d’espérer ou des raisons de renoncer. Il lutte, résiste, s’effondre, reprend espoir et finit par se ranger à l’avis des trois avocats qui l’entourent et ont entrepris de plaider l’innocence au nom des droits que lui confère la Constitution. Peine perdue. Pas plus qu’il ne saurait être jugé comme monarque absolu, Louis XVI ne saurait l’être comme roi constitutionnel puisque la monarchie n’est plus, et pas davantage comme citoyen ordinaire puisqu’il ne l’est pas.
Fondé sur des sources de première main, La Mort du Roi donne vie, dans un va-et-vient permanent entre la prison du Temple et la Convention, aux lignes de force qui conduisent à la mort et font de la France une nation à nulle autre pareille.
Qui est l'auteur ?
Olivier Bétourné est historien de la Révolution française et éditeur, cofondateur et président de l’Institut Histoire et Lumières de la pensée. Il est notamment l’auteur de L’Esprit de la Révolution française (Seuil, 2022)

La nuit, la neige- Messages : 18132
Date d'inscription : 21/12/2013
 Re: La mort du roi, Louis XVI devant ses juges et face à l'Histoire. De Olivier Bétourné
Re: La mort du roi, Louis XVI devant ses juges et face à l'Histoire. De Olivier Bétourné
La formule est un peu singulière...La nuit, la neige a écrit:
... La Mort du Roi donne vie, dans un va-et-vient permanent entre la prison du Temple et la Convention, aux lignes de force qui conduisent à la mort et font de la France une nation à nulle autre pareille.

_________________
... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55497
Date d'inscription : 21/12/2013
Localisation : l'Ouest sauvage

Monsieur de la Pérouse- Messages : 504
Date d'inscription : 31/01/2019
Localisation : Enfin à bon port !
 Re: La mort du roi, Louis XVI devant ses juges et face à l'Histoire. De Olivier Bétourné
Re: La mort du roi, Louis XVI devant ses juges et face à l'Histoire. De Olivier Bétourné
...

_________________
... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55497
Date d'inscription : 21/12/2013
Localisation : l'Ouest sauvage
 Sujets similaires
Sujets similaires» Le roi Louis XV, dit le Bien-Aimé
» L'amour à Paris au temps de Louis XVI, de Olivier Blanc
» L'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793
» La mort de Louis XV
» La mort du roi Louis XIV ?
» L'amour à Paris au temps de Louis XVI, de Olivier Blanc
» L'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793
» La mort de Louis XV
» La mort du roi Louis XIV ?
LE FORUM DE MARIE-ANTOINETTE :: Bibliographie :: Bibliographie : La Révolution française et le XIXe siècle :: Biographies, essais et études
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum